
ENGLISH TEXT BELOW
Les Antilles, doux rivages sujets à bien des clichés d’un autre âge. La carte postale des cocotiers, du verre de rhum qu’on sirote, des robes madras qu’on trouve tellement exotiques… Presqu’autant que la compagnie créole, et des couplets « doudouistes » qui en disent long sur les malentendus de part et d’autre de l’océan. Cette vision déformée colle encore à la peau des Antillais, comme au bon vieux temps des colonies. Car sous le vernis d’images moisies, se trame une toute autre réalité. Ils tapent sur des tambours mais ils ne furent jamais numéro un, pour détourner le refrain d’un chanteur français né en Martinique. C’est de ceux-là dont parle cette sélection, de musiciens qui tambourinent sur des percussions, histoire d’affirmer leur identité créolisée. De chansons qui à mots couverts raconte un autre quotidien que celui que l’on a donné à la becquée aux Métropolitains. Des cas à part, dont les cris de joie comme les complaintes s’accompagnent de cadences qui invitent à la transe, toutes baignées dans le melting-pot rythmique caribéen.
Antilles Méchant Bateau, un low tempo aux faux airs de boléro, en fait un pur coup de blues et un terrible solo de saxophone. Quoi de plus normal pour donner le diapason de cette sélection, où la biguine reprend ses couleurs d’origine, plongée dans la noirceur du tambour gwo ka. Ce 45-tours sous étiquète Aux Ondes fut enregistré par André Mahy dans les années 1960 chez Cellini, l’une des deux grandes maisons de la Guadeloupe. Dans ses roulements de tambours comme dans son chant déchirant, il rappelle qu’avant d’en arriver là, au mitan des années 1960, l’histoire des Antilles s’est écrite dans l’océan de larmes que fut l’Atlantique noir dont parle si bien le poète philosophe martiniquais Edouard Glissant dans L’Archipel des Grands Chaos.
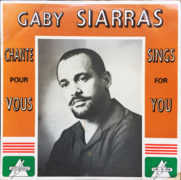 Ces maudits bateaux, que l’on appelait « négriers », transportèrent des siècles durant des millions d’Africains vers le continent américain. Toute cette sinistre histoire avait commencé par l’arrivée d’une flotte de caravelles gouvernée par Christophe Colomb en 1492. Ce fut le premier pas d’une colonisation qui allait décimer les peuples indigènes de cette terra incognita et déporter les forces vives du continent berceau de l’humanité. Un an plus tard, le 4 novembre 1493, le même Colomb baptisera la Guadeloupe en hommage au monastère Santa Maria de Guadeloupe de Estramadura. La croix, symbole porteur, sera là pour justifier le calvaire de peuples à qui l’on nie même toute humanité. Très vite, après l’éradication des tribus Caraïbes, les Français vont y importer massivement de la main-d’œuvre du Ghana, du Togo, du Dahomey, de Côte-d’Ivoire, du Nigeria, du Cameroun, du Gabon, du Congo ou encore d’Angola, comme le rappellent en 2012 les Marches dédiées aux différentes ethnies des esclaves, qui font face au Mémorial du tambour ka sur Grande Terre, en Guadeloupe.
Ces maudits bateaux, que l’on appelait « négriers », transportèrent des siècles durant des millions d’Africains vers le continent américain. Toute cette sinistre histoire avait commencé par l’arrivée d’une flotte de caravelles gouvernée par Christophe Colomb en 1492. Ce fut le premier pas d’une colonisation qui allait décimer les peuples indigènes de cette terra incognita et déporter les forces vives du continent berceau de l’humanité. Un an plus tard, le 4 novembre 1493, le même Colomb baptisera la Guadeloupe en hommage au monastère Santa Maria de Guadeloupe de Estramadura. La croix, symbole porteur, sera là pour justifier le calvaire de peuples à qui l’on nie même toute humanité. Très vite, après l’éradication des tribus Caraïbes, les Français vont y importer massivement de la main-d’œuvre du Ghana, du Togo, du Dahomey, de Côte-d’Ivoire, du Nigeria, du Cameroun, du Gabon, du Congo ou encore d’Angola, comme le rappellent en 2012 les Marches dédiées aux différentes ethnies des esclaves, qui font face au Mémorial du tambour ka sur Grande Terre, en Guadeloupe.
Ils seront ainsi des centaines de milliers à devoir survivre dans l’enfer des habitations, ce système comparable à celui des plantations dans le Sud des Etats-Unis : les chaînes, fers aux pieds, entraves, carcans, garrot, colliers et masques de fer, cachots, lynchage rythment le quotidien. L’aristocratie sucrière, l’or brun de l’époque, fait alors régner un régime de terreur sur les habitations. Le maître y a les pleins pouvoirs, de vie et de mort, sur les esclaves, qui travaillent de 4 heures du matin au coucher du soleil. Il faudra attendre le 27 avril 1848, date de la seconde et définitive abolition de l’esclavage (une première eut lieu avec la révolution, vite réprimée dans le sang par Bonaparte…) grâce au combat du député Victor Schoelcher, proche de Lamartine. Le chemin sera néanmoins encore long pour que soit appliquée la devise au fronton de la République : Liberté, Egalité, Fraternité… La société « post-esclavagiste » fera perdurer une réelle ségrégation économique, une distinction reproduite de génération en génération… Et quand bien même, près d’un siècle plus tard, la loi du 19 mars 1946 octroie le statut de Départements d’Outre Mer aux quatre vieilles colonies, cela ne change rien au cours de l’histoire. Ce fossé dès lors se creusera, autrement mais sûrement, à mesure que la République met en pratique une politique d’assimilation qui nie les identités et fait table rase du passé.
 Dans ce jeu de dupes, le ka va devenir dès les années 1960 la voix identitaire pour les Guadeloupéens qui ne peuvent se résoudre à être purement et simplement désintégrés. Fabriqué à partir d’un tonneau de salaison ou de vin utilisé à l’époque coloniale – les bateaux, on y revient sans cesse dans ce mouvement de flux et reflux –, le « quart », devenu « ka » une fois créolisé, fut dès l’époque coloniale le puissant symbole de résistance. Même si sa pratique fut vite proscrite par les maîtres, estimant qu’il contient les germes de révolte, ce grand tambour (longtemps désigné par le terme bamboula !… qui signifie la fête païenne à Haïti, qui deviendra même une expression populaire dans la France des années De Gaulle) s’incruste inexorablement dans la culture locale, jusqu’à devenir le creuset essentiel du mouvement de la musique racine face à une métropole sourde. Son cœur battant, suivant les sept rythmes spécifiques du gwo ka.
Dans ce jeu de dupes, le ka va devenir dès les années 1960 la voix identitaire pour les Guadeloupéens qui ne peuvent se résoudre à être purement et simplement désintégrés. Fabriqué à partir d’un tonneau de salaison ou de vin utilisé à l’époque coloniale – les bateaux, on y revient sans cesse dans ce mouvement de flux et reflux –, le « quart », devenu « ka » une fois créolisé, fut dès l’époque coloniale le puissant symbole de résistance. Même si sa pratique fut vite proscrite par les maîtres, estimant qu’il contient les germes de révolte, ce grand tambour (longtemps désigné par le terme bamboula !… qui signifie la fête païenne à Haïti, qui deviendra même une expression populaire dans la France des années De Gaulle) s’incruste inexorablement dans la culture locale, jusqu’à devenir le creuset essentiel du mouvement de la musique racine face à une métropole sourde. Son cœur battant, suivant les sept rythmes spécifiques du gwo ka.
Plus qu’une simple affaire de rythmes, ce tambour charrie une parole chargée d’histoire et d’histoires, un message porteur de mémoire et d’espoirs. Le gwo ka porte en lui les stigmates de la société esclavagiste, et les chants qui lui sont associés en sont tous hérités. Medium des sans-voix, ce tambour sera un onguent sur les corps maltraités, mais aussi un stimulant pour les âmes rebelles. Sous les doigts du frappeur, le ka bat le rappel des ancêtres. Tout comme les paroles convoquent la mémoire d’un peuple longtemps rangé au stade de simple bien meuble, selon l’article 44 du Code Noir érigé en 1685 par Colbert afin de réglementer le statut des esclaves, avant d’être régi par le système du livret qui permettait de surveiller les déplacements et le travail de la main-d’œuvre dans une Guadeloupe, certes libérée de l’esclavage, mais encore aux faux airs de régime « bananier ». Ce trauma transpire au fil d’un répertoire où se retrouve la douleur des coupeurs de canne et l’ivresse du jour de paie, l’oppression du racisme et le recours au mythe d’une terre promise. Au fil des chansons, se bousculent tout le bestiaire qui peuple les campagnes et les nombreux poissons qui alimentent les ragoûts, se côtoient satyres acides sur la réalité au quotidien et saillies bien senties sur l’actualité internationale, chroniques ancrées dans le terroir local et jeux de mots acérés. On peut chanter pour un mort que l’on veille, ou se lancer lors d’une soirée bien arrosée dans de longues tirades, pleines de sous-entendus coquins.
 Au tournant des années 1960, alors que certains bars sont encore réservés aux Blancs, alors qu’on interdit de parler le créole dans les cours d’école, alors que l’on considère le tambour comme une « mizik à vié neg », alors que l’église y voit un symbole de dégénérescence, l’esprit marron – le nom des esclaves ayant fui les habitations pour vivre libre dans les bois – renaît de ses tréfonds, sous une autre forme. Dans cette décennie et celle qui suit, ce mouvement qui redonne toute sa place aux percussions accompagne les revendications qui se font plus précises tandis que les îles anglophones accèdent à l’indépendance. Jouer du ka, banni des studios officiels, c’est déjà choisir son camps. A partir de 1963, le Bumidom (Bureau pour la Migration des Départements d’Outre-Mer) nouvellement institué par Michel Debré organise une forte émigration antillaise vers des emplois peu qualifiés et la vie terne des banlieues. En réponse le Gong (Groupe O Nationale de la Guadeloupe) appelle à l’Indépendance pour la Guadeloupe, et deux ans plus tard, le Front Guadeloupéen pour l’Autonomie naît. Ces années sont rythmées de grèves, de répressions dont le point d’orgue sera mai 1967. Un massacre en place publique, à Pointe-à-Pitre, dont on tait jusqu’en 2012 le bilan officiel. Ils seront nombreux à dénoncer les saignées opérées par le Bumidom dans les forces vives de la Guadeloupe. Sur les murs fleurissent des slogans dont l’emblématique : « Jeune, ne quitte pas ton pays. »
Au tournant des années 1960, alors que certains bars sont encore réservés aux Blancs, alors qu’on interdit de parler le créole dans les cours d’école, alors que l’on considère le tambour comme une « mizik à vié neg », alors que l’église y voit un symbole de dégénérescence, l’esprit marron – le nom des esclaves ayant fui les habitations pour vivre libre dans les bois – renaît de ses tréfonds, sous une autre forme. Dans cette décennie et celle qui suit, ce mouvement qui redonne toute sa place aux percussions accompagne les revendications qui se font plus précises tandis que les îles anglophones accèdent à l’indépendance. Jouer du ka, banni des studios officiels, c’est déjà choisir son camps. A partir de 1963, le Bumidom (Bureau pour la Migration des Départements d’Outre-Mer) nouvellement institué par Michel Debré organise une forte émigration antillaise vers des emplois peu qualifiés et la vie terne des banlieues. En réponse le Gong (Groupe O Nationale de la Guadeloupe) appelle à l’Indépendance pour la Guadeloupe, et deux ans plus tard, le Front Guadeloupéen pour l’Autonomie naît. Ces années sont rythmées de grèves, de répressions dont le point d’orgue sera mai 1967. Un massacre en place publique, à Pointe-à-Pitre, dont on tait jusqu’en 2012 le bilan officiel. Ils seront nombreux à dénoncer les saignées opérées par le Bumidom dans les forces vives de la Guadeloupe. Sur les murs fleurissent des slogans dont l’emblématique : « Jeune, ne quitte pas ton pays. »
Message reçu par une partie de la jeunesse qui choisit de reprendre en mains le tambour, tel un symbole d’une identité émasculée de ce peuple «entièrement à part», pour reprendre la formule d’Aimé Césaire, père de la Négritude. Le ka sera la bande-son de cette génération, qui accélère le tempo avec les années 70 et le transplante définitivement en ville, tandis que l’économie de la plantation, terroir originel du ka, est en crise. Dès lors, les vieux tambouyés sont célébrés à leur juste valeur : Anzala, Carnot, Serge Dolor, Ti Seles, Robert Loyson, Arthème Boisban, Esnard Boisdur… et surtout Velo – Marcel Lollia, pour l’état-civil – qui meurt néanmoins dans la misère, en pleine rue, en 1984. « Champs de canne, champs de coton ! », s’exclamera Guy Konket, l’un des grands chantres de la cause guadeloupéenne dont le sillon s’inscrit dans cet héritage, tout en le déplaçant sur le bitume de Carénages, quartier chaud de Pointe-à-Pitre. Le poète a le sens de la formule qui frappe juste, comme son tambour de bouche.
 Pas de doute, blues et ka, même combat, des siècles d’oppression, de négation, avant de trouver le chemin d’une possible rédemption. Entre eux, la même langue, celle des esprits créoles, submergés dans le grand océan. C’est de ceux-là dont parle cette sélection, où le bon sens de l’humour né doit pas masquer les billets d’humeur entre les lignes. Le jazz y infuse une énergie émancipatrice des formats consacrés, conférant à ces chansons une musicalité qui rime avec spiritualité. Entre cadences infernales qui empruntent aux rythmes « latins » des îles voisines, biguines au tempo épicé de percussions et ballades plus à la coule, pas moins sombres, cette compilation nous replonge dans les premières heures d’un mouvement de renaissance synonyme de reconnaissance. Un bain de jouvence où toutes les musiques de la diaspora née dans l’Atlantique noir s’entremêlent naturellement. Telle une vague de sons, de sens et de sang qui rappelle que du fond des cales de ces méchants bateaux a surgi une culture originale, dont la trace demeure des plus tenaces en 2018.
Pas de doute, blues et ka, même combat, des siècles d’oppression, de négation, avant de trouver le chemin d’une possible rédemption. Entre eux, la même langue, celle des esprits créoles, submergés dans le grand océan. C’est de ceux-là dont parle cette sélection, où le bon sens de l’humour né doit pas masquer les billets d’humeur entre les lignes. Le jazz y infuse une énergie émancipatrice des formats consacrés, conférant à ces chansons une musicalité qui rime avec spiritualité. Entre cadences infernales qui empruntent aux rythmes « latins » des îles voisines, biguines au tempo épicé de percussions et ballades plus à la coule, pas moins sombres, cette compilation nous replonge dans les premières heures d’un mouvement de renaissance synonyme de reconnaissance. Un bain de jouvence où toutes les musiques de la diaspora née dans l’Atlantique noir s’entremêlent naturellement. Telle une vague de sons, de sens et de sang qui rappelle que du fond des cales de ces méchants bateaux a surgi une culture originale, dont la trace demeure des plus tenaces en 2018.
Jacques Denis
///////////////////////////////////////////////
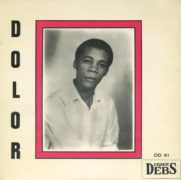 The West Indies – a sweet coastline subject to many clichés from another time. That postcard with coconut trees, a glass of rum to sip on, those so exotic madras dresses… Almost as many as in Compagnie Créole’s “doudouist” songs, that say a lot about the misunderstandings from both sides of the ocean. West Indians are still as stuck with this distorted outlook as in the good old days of the colonies. Because, underneath the veneer of moldy images, a completely different reality is woven. ‘They beat drums but were never number one’ – to misquote the chorus by a Martinique-born French singer. This is the subject of this collection – musicians drumming on percussion as a way of asserting their creolized identity. Songs that tell, in veiled terms, a different reality from what mainlanders were fed with. Special cases, with cries of joy and laments accompanied by cadences, as an invitation to trance, all immersed in the Caribbean melting pot of rhythm.
The West Indies – a sweet coastline subject to many clichés from another time. That postcard with coconut trees, a glass of rum to sip on, those so exotic madras dresses… Almost as many as in Compagnie Créole’s “doudouist” songs, that say a lot about the misunderstandings from both sides of the ocean. West Indians are still as stuck with this distorted outlook as in the good old days of the colonies. Because, underneath the veneer of moldy images, a completely different reality is woven. ‘They beat drums but were never number one’ – to misquote the chorus by a Martinique-born French singer. This is the subject of this collection – musicians drumming on percussion as a way of asserting their creolized identity. Songs that tell, in veiled terms, a different reality from what mainlanders were fed with. Special cases, with cries of joy and laments accompanied by cadences, as an invitation to trance, all immersed in the Caribbean melting pot of rhythm.
“’Antilles’ Méchant Bateau”, a low-tempo number with a bolero feel, indeed a pure case of the blues, and a terrific saxophone solo. What else would you expect to set the tone for this selection, in which beguine regains its original colors, in the darkness of the gwo ka drums. This 45 by André Mahy, released under the Aux Ondes sublabel, was recorded in the 1960s at Célini’s, one of Guadeloupe’s two main houses. Through its drum rolls and harrowing chant, it recalled how, long before the mid-1960s, the Antilles’ history was written in an ocean of teardrops – namely the Black Atlantic, as so rightly put by Martinician philosopher and poet Edouard Glissant in L’Archipel des Grands Chaos.
These “cursed boats” – slavers – carried millions of Africans to the American continent for centuries. All this sinister story had begun with the landing of a fleet of caravels steered by Christopher Columbus in 1492. It was the first step towards a colonization that was about to decimate the indigenous peoples of this terra incognita and deport the vital spark from the cradle continent of humankind. A year later, on November 4th, 1493, the same Colombus christened Guadeloupe after the Royal Monastery of Santa María de Guadalupe in Extremadura. The cross – a booming symbol – was there to justify the ordeal of peoples to whom even humanness was denied. Soon, once the Caribbean tribes were eradicated, the French would massively import workforce from Ghana, Togo, Dahomey, Ivory Coast, Nigeria, Cameroon, Gabon, Congo or Angola, as recalled by the Marches dedicated to the various ethnicities of slaves in 2012, which faced the Memorial of the ka drum on the Grande-Terre island in Guadeloupe.
 Hundreds of thousands of them would have to survive the nightmare of plantations, comparable to the plantation system in the American South: chains, leg irons, shackles, fetters, garottes, iron collars and branks, dungeons or lynchings set the tempo of everyday life. The sugar aristocracy (the brown gold of the time) set a reign of terror on plantations. The masters had full powers, including life and death, over the slaves who worked from four in the morning to sunset… until April 27th, 1848 – date of the second and definitive abolition of slavery thanks to the struggle of Victor Schœlcher, an MP who was close to Lamartine (the first one had been pronounced in the wake of the French Revolution, but soon repressed in blood by Bonaparte…). However, the path would still be long to see the newly-born Republic’s motto applied: Liberty, Equality, Fraternity … The “post-slavery” society would perpetuate real economic segregation – a distinction that would be reproduced from generation to generation… And even if, a century later, the law of 19th March 1946 granted the four old colonies the status of Overseas Departments, nothing changed in the course of history. This gap would then widen, differently but surely, as the Republic implemented an assimilation policy that would deny identities and make a clean break with the past.
Hundreds of thousands of them would have to survive the nightmare of plantations, comparable to the plantation system in the American South: chains, leg irons, shackles, fetters, garottes, iron collars and branks, dungeons or lynchings set the tempo of everyday life. The sugar aristocracy (the brown gold of the time) set a reign of terror on plantations. The masters had full powers, including life and death, over the slaves who worked from four in the morning to sunset… until April 27th, 1848 – date of the second and definitive abolition of slavery thanks to the struggle of Victor Schœlcher, an MP who was close to Lamartine (the first one had been pronounced in the wake of the French Revolution, but soon repressed in blood by Bonaparte…). However, the path would still be long to see the newly-born Republic’s motto applied: Liberty, Equality, Fraternity … The “post-slavery” society would perpetuate real economic segregation – a distinction that would be reproduced from generation to generation… And even if, a century later, the law of 19th March 1946 granted the four old colonies the status of Overseas Departments, nothing changed in the course of history. This gap would then widen, differently but surely, as the Republic implemented an assimilation policy that would deny identities and make a clean break with the past.
In this fool’s game, the ka became, in the 1960s, the voice of identity for Guadeloupeans who couldn’t resolve being purely and solely disintegrated. Made from salting or wine barrels from the colonial era – boats keep coming back in this ebb and flow movement – the “quarter”, or “ka” once creolized, was a powerful symbol of resistance since the colonial era. Even if its practice was quickly proscribed by masters, considering it contained the seeds of revolt, this great drum (long known as a ‘bamboula’, which means ‘pagan festival’ in Haiti, and became a popular expression in De Gaulle’s France) inexorably wormed its way into the local culture, until becoming the essential melting pot for the movement of ‘root music’ against mainland France’s deaf hear. Or its beating heart, following the seven specific rhythms of gwo ka.
 More than just a matter of rhythms, this drum carried a speech full of history and stories, a message of memories and hopes. The gwo ka bore the stigmata of a slave society, from which all its associated chants were inherited. A medium of the voiceless, this drum would act like an ointment on mistreated bodies, but also as a stimulant for rebellious souls. Under the drummer’s fingers, the ka drummed up the ancestors’ spirits. Just like words convey the memory of a people that was long demoted to the status of a simple item of personal property – according to article 44 of the 1685 Code Noir draught by Colbert to regulate the status of slaves – before being governed by a system of identification booklets allowing to monitor the movements and work of the workforce in a Guadeloupe admittedly liberated from slavery, but still looking like a “banana” regime. This trauma appears through a repertoire that reflects the pain of cane cutters and the euphoria of pay day, the oppression of racism and the recourse to the myth of a promised land. Songs burst with all the bestiary that populates the countryside and the many fish that feed stews, acid satires on the daily reality and apposite witticisms on international events, chronicles anchored in the local soil as well as biting plays on words. One may sing to keep vigil over a dead person, or launch into long, saucy tirades at a bibulous party.
More than just a matter of rhythms, this drum carried a speech full of history and stories, a message of memories and hopes. The gwo ka bore the stigmata of a slave society, from which all its associated chants were inherited. A medium of the voiceless, this drum would act like an ointment on mistreated bodies, but also as a stimulant for rebellious souls. Under the drummer’s fingers, the ka drummed up the ancestors’ spirits. Just like words convey the memory of a people that was long demoted to the status of a simple item of personal property – according to article 44 of the 1685 Code Noir draught by Colbert to regulate the status of slaves – before being governed by a system of identification booklets allowing to monitor the movements and work of the workforce in a Guadeloupe admittedly liberated from slavery, but still looking like a “banana” regime. This trauma appears through a repertoire that reflects the pain of cane cutters and the euphoria of pay day, the oppression of racism and the recourse to the myth of a promised land. Songs burst with all the bestiary that populates the countryside and the many fish that feed stews, acid satires on the daily reality and apposite witticisms on international events, chronicles anchored in the local soil as well as biting plays on words. One may sing to keep vigil over a dead person, or launch into long, saucy tirades at a bibulous party.
At the turn of the 1960s, while some bars were still for whites only, while speaking Creole was forbidden in schoolyards, while drum music was considered a “mizik vié neg” (“old negro music”), while the church saw a symbol of degeneration in it, the Maroon spirit – from the name of the slaves who fled plantations to live free in the woods – rose from its depths, in another form. In this decade and the one that followed, this movement, that gave its place back to percussion, accompanied more precise claims as English-speaking islands gained independence. By playing the ka (which was banned from official studios), one actually chose their side. From 1963, the freshly-instituted Bumidom (Office for Overseas Migration) organized a strong West-Indian emigration towards low-skilled jobs and a dull suburban life. In response, the Gong (group for Guadeloupe’s National Organization) called for Guadeloupe’s independence, and two years later, the Guadeloupean Front for Autonomy appeared. Those years were punctuated by strikes and repressions, culminating in May 1967 with a real massacre in the public square in Pointe-à-Pitre, the toll of which would not be disclosed until 2012. Many would denounce the bloodbath operated by the Bumidom among Guadeloupe’s lifeblood. Slogans flourished on walls, including the iconic: Jeune, ne quitte pas ton pays (“Young people, do not leave your country”).
 Part of the youth got the message, choosing to take the drum back in hand as a symbol of the emasculated identity of this “entirely apart” people, to quote Aimé Césaire, the father of Negritude. The ka became the soundtrack of this generation, who sped up the tempo with the 70s and definitely transplanted it to town, while the plantation economy – the original soil of the ka drum – was in crisis. From then on, the old tambouyés (drummers) finally went celebrated as they should be: Anzala, Carnot, Serge Dolor, Ti Seles, Robert Loyson, Arthème Boisban, Esnard Boisdur … and especially Velo – born Marcel Lollia – who nevertheless died in misery, in the street, in 1984. “Champs de canne, champs de coton !” (“Cane fields, cotton fields!) Guy Konket roared, one of the great champions of the Guadeloupean cause, whose path followed on from this legacy, moving it onto the asphalt of Carénages, Pointe-à-Pitre’s hot district. The poet sure had a good turn of phrase, that hit the spot just like his mouth drum.
Part of the youth got the message, choosing to take the drum back in hand as a symbol of the emasculated identity of this “entirely apart” people, to quote Aimé Césaire, the father of Negritude. The ka became the soundtrack of this generation, who sped up the tempo with the 70s and definitely transplanted it to town, while the plantation economy – the original soil of the ka drum – was in crisis. From then on, the old tambouyés (drummers) finally went celebrated as they should be: Anzala, Carnot, Serge Dolor, Ti Seles, Robert Loyson, Arthème Boisban, Esnard Boisdur … and especially Velo – born Marcel Lollia – who nevertheless died in misery, in the street, in 1984. “Champs de canne, champs de coton !” (“Cane fields, cotton fields!) Guy Konket roared, one of the great champions of the Guadeloupean cause, whose path followed on from this legacy, moving it onto the asphalt of Carénages, Pointe-à-Pitre’s hot district. The poet sure had a good turn of phrase, that hit the spot just like his mouth drum.
No doubt, blues and ka fought the same battle – centuries of oppression, of negation, before finding the path to possible redemption. Between them, the same language – the language of the Creole spirits, flooded in the great ocean. This is what this selection is about, and its good, inborn sense of humor shouldn’t hide the implicit commentaries. There, jazz instills an emancipating energy from established formats, giving these songs a musicality that rhymes with spirituality. From infernal cadences borrowing from the “latin” rhythms of neighboring islands, to beguines with percussion-spiced tempos, to more laid-back – nonetheless dark – ballads, this compilation takes us back to the early hours of a movement of rebirth synonymous with recognition. A rejuvenation in which all the musics from the Black Atlantic diaspora naturally intertwine. Like a wave of sounds, of sense and blood, reminding us that an original culture emerged from the holds of these ‘wicked boats’, the trace of which remains starkly persistent in 2018.
Jacques Denis

